TOUS LES TITRES

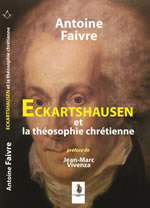
Eckartshausen et la théosophie chrétienne
Un volume de 15, 5 x 24 de 790 pages et 18 planches hors-texte, couverture illustrée. Cette seconde édition reproduit à l’identique le texte de la première (Paris : Klincksieck, 1969) avec, en plus, un Avant-Propos de l’auteur Pour Cette Seconde Édition, une Préface (par Jean-Marc Vivenza), et en annexe une édition commentée de la correspondance échangée entre Eckartshausen et Sergueï Ivanovitch Plechtcheev
Voici une seconde édition du premier – et dernier, jusqu’à ce jour – ouvrage d’ensemble sur le Munichois Karl von Eckartshausen (1752-1803), contemporain du Siècle des lumières et représentant de l’Illuminisme chrétien. L’historien rencontre souvent ce théosophe, alchimiste, arithmosophe, dont la personnalité était demeurée dans l’ombre et dont l’œuvre (plus de cent titres) se situe aux sources mêmes de la philosophie romantique. L’ouvrage repose non seulement sur l’étude de textes imprimés, mais aussi sur celle de nombreux documents (correspondances, notamment) jusqu’alors inédits.
La première partie présente l’homme dans son époque et son milieu. Il y est question, d’une part, de ses activités au sein de l’Académie de Bavière et dans le contexte religieux, philosophique et littéraire du XVIIIe siècle finissant ; d’autre part, de ses rapports avec diverses sociétés initiatiques (à caractère ésotérique, mais aussi politique comme celle des Illuminés de Bavière) ainsi qu’avec des personnages tels que Conrad Schmid, Josef von Thun, Johann Heinrich Jung-Stilling, Niklaus Anton Kirchberger, Louis de Divonne, Louis-Claude de Saint-Martin, Ivan Lopouchine, Sergueï Ivanovitch Plechtcheev, etc.
La seconde partie est consacrée à la pensée proprement dite d’Eckartshausen, étudiée tant à travers ses écrits que dans le contexte de courants ésotériques dont il se réclame (Kabbale chrétienne, théosophie dans la mouvance de Jacob Böhme, ‘science’ des nombres…). Dans cette perspective sont présentés des chapitres tels que : L’analogie ; Les Esprits ; L’Adam primordial et sa chute ; La Régénération de l’Homme et de la Nature ; Ésotérisme et Église Intérieure ; Kantisme et théorie de la médiation ; Arithmosophie ; Pneumatologie ; La notion de ‘Magique’; Palingénésie ; Alchimie ; Magnétisme animal…
La dernière partie, intitulée Le Rayonnement de l’œuvre, est consacrée à la réception d’Eckartshausen. En Allemagne, d’abord : témoignages de Johann Gottfried Herder, Johann Caspar Lavater, Johann Wolfgang Goethe, Johann Friedrich Schiller, Karl Heinrich Jung-Stilling, Justinus Kerner, Novalis, etc. En France, il est présent chez Senancour, Éliphas Lévi, Édouard Schuré, René Guénon, etc. Il a exercé un certain rayonnement en Angleterre aussi (où Aleister Crowley l’appelait « the divine philosopher »), mais surtout en Russie, sous Alexandre 1er (le tsar lisait ses œuvres, que Mme de Krüdener commentait pour lui). Antoine Faivre décrit le contexte ‘mystique’et maçonnique dans lequel s’exerça son influence en ce pays, et relève maintes traces qu’il a laissées dans les œuvres d’Alexandre Herzen, Nicolas Gogol, Ivan Gontcharov, Léon Tolstoï, Nikolaï Lesskov.
Plusieurs appendices, et un index des noms propres, complètent l’ouvrage.

Un volume de 15, 5 x 24 de 790 pages et 18 planches hors-texte, couverture illustrée. Cette seconde édition reproduit à l’identique le texte de la première (Paris : Klincksieck, 1969) avec, en plus, un Avant-Propos de l’auteur Pour Cette Seconde Édition, une Préface (par Jean-Marc Vivenza), et en annexe une édition commentée de la correspondance échangée entre Eckartshausen et Sergueï Ivanovitch Plechtcheev
Voici une seconde édition du premier – et dernier, jusqu’à ce jour – ouvrage d’ensemble sur le Munichois Karl von Eckartshausen (1752-1803), contemporain du Siècle des lumières et représentant de l’Illuminisme chrétien. L’historien rencontre souvent ce théosophe, alchimiste, arithmosophe, dont la personnalité était demeurée dans l’ombre et dont l’œuvre (plus de cent titres) se situe aux sources mêmes de la philosophie romantique. L’ouvrage repose non seulement sur l’étude de textes imprimés, mais aussi sur celle de nombreux documents (correspondances, notamment) jusqu’alors inédits.
La première partie présente l’homme dans son époque et son milieu. Il y est question, d’une part, de ses activités au sein de l’Académie de Bavière et dans le contexte religieux, philosophique et littéraire du XVIIIe siècle finissant ; d’autre part, de ses rapports avec diverses sociétés initiatiques (à caractère ésotérique, mais aussi politique comme celle des Illuminés de Bavière) ainsi qu’avec des personnages tels que Conrad Schmid, Josef von Thun, Johann Heinrich Jung-Stilling, Niklaus Anton Kirchberger, Louis de Divonne, Louis-Claude de Saint-Martin, Ivan Lopouchine, Sergueï Ivanovitch Plechtcheev, etc.
La seconde partie est consacrée à la pensée proprement dite d’Eckartshausen, étudiée tant à travers ses écrits que dans le contexte de courants ésotériques dont il se réclame (Kabbale chrétienne, théosophie dans la mouvance de Jacob Böhme, ‘science’ des nombres…). Dans cette perspective sont présentés des chapitres tels que : L’analogie ; Les Esprits ; L’Adam primordial et sa chute ; La Régénération de l’Homme et de la Nature ; Ésotérisme et Église Intérieure ; Kantisme et théorie de la médiation ; Arithmosophie ; Pneumatologie ; La notion de ‘Magique’; Palingénésie ; Alchimie ; Magnétisme animal…
La dernière partie, intitulée Le Rayonnement de l’œuvre, est consacrée à la réception d’Eckartshausen. En Allemagne, d’abord : témoignages de Johann Gottfried Herder, Johann Caspar Lavater, Johann Wolfgang Goethe, Johann Friedrich Schiller, Karl Heinrich Jung-Stilling, Justinus Kerner, Novalis, etc. En France, il est présent chez Senancour, Éliphas Lévi, Édouard Schuré, René Guénon, etc. Il a exercé un certain rayonnement en Angleterre aussi (où Aleister Crowley l’appelait « the divine philosopher »), mais surtout en Russie, sous Alexandre 1er (le tsar lisait ses œuvres, que Mme de Krüdener commentait pour lui). Antoine Faivre décrit le contexte ‘mystique’et maçonnique dans lequel s’exerça son influence en ce pays, et relève maintes traces qu’il a laissées dans les œuvres d’Alexandre Herzen, Nicolas Gogol, Ivan Gontcharov, Léon Tolstoï, Nikolaï Lesskov.
Plusieurs appendices, et un index des noms propres, complètent l’ouvrage.
